
EN DEUX MOTS : Moins de deux ans après une 6e salve assez décevante, la série d’anticipation BLACK MIRROR revient sur Netflix avec une saison plus consistante. 6 nouveaux épisodes complète toujours un peu plus le catalogue de cette saga qui navigue cette fois entre la romance dystopique, la comédie acide paranoïaque, le concept S.F. qui mélange I.A. et films noirs ou encore la fable dramatique mélancolique.
Et si on ne peut que se réjouir du retour d’une saison plus complète en 6 chapitres, et notamment après deux saisons (2019 et 2023) oubliables, Black Mirror intrigue avec quelques nouveaux épisodes qui donne suite à plusieurs intrigues du passé. (où se place dans le même univers). Dont le formidable USS Callister (saison 4 – 2017) ou son épisode interactif Bandersnatch (2018).

À l’arrivée si cette saison se révèle assez consistante, le souvenir tranchant des premières saisons semblent toujours aussi lointain. Celles qui mêlaient si bien un cynisme à la noirceur abyssale comme la fable romantique tendre. Pourtant, son créateur Charlie Brooker reste aux manettes et narre l’ensemble de ses 6 segments. Tout comme cette saison rappelle quelques-uns de ses réalisateurs précédents. À l’instar de Toby Haynes (qui réalise deux épisodes aujourd’hui) ou David Slade (réalisateur de Bandersnatch).
Et si Black Mirror avait tout simplement offert tout ce qu’elle avait déjà à offrir ? Et c’était peu à peu transformer en un sympathique produit de consommation vite regardé, vite oublié… ? Peut-être pas, car quelques belles petites surprises subsistent.
Épisode 1 : Common People
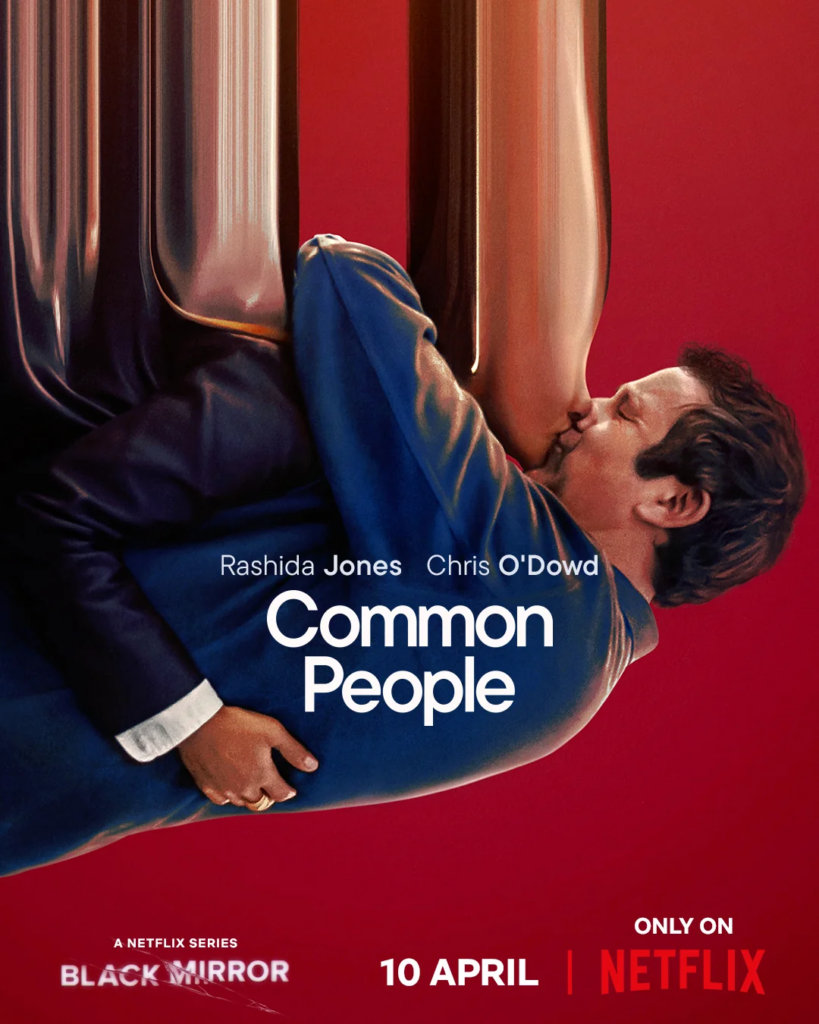
Quand une enseignante se retrouve entre la vie et la mort, son mari dévoué l’inscrit dans un dispositif de haute technologie qui la maintient en vie, mais à un certain prix.
Avec son postulat purement S.F. ce premier épisode s’inscrit dans la pure tradition satirique de la saga Black Mirror. Et ce, en plaçant deux personnages sympathiques, lambdas, chargés d’optimisme sur l’avenir et sans gros revenus (en effet renforcé par leurs environnements vintages) dépendant à une technologie révolutionnaire qui va ternir leurs vies. Common People renforce alors ce sentiment d’impuissance face à la dépendance du « progrès » via un cynisme fou.
Rashida Jones et Chris O’ Dowd incarnent plutôt idéalement ses protagonistes pris dans une spirale infernale autour de quelques idées de scénario bien pensée. Comme celle d’une conscience récitant des pubs contre sa volonté ou ce mari dévoué qui s’adonne aux déviances sur Internet pour payer des factures de plus en plus élevées. Le tout pour accéder à différents services Rivermind, qui rappellent les services de streaming actuel avec leur version « standard » ou « premium ». Il s’agit assurément du point fort de cet épisode d’une heure, qui favorise un montage assez soutenu pour développer son propos au mieux.
Néanmoins, avec sa mise en scène académique et sans âme (signer Ally Pankiw) et une exécution qui manque d’images chocs, Common People s’avère ironiquement trop ordinaire. Surtout dans la veine de cette saga iconique qui nous à habitué à bien plus choquant ou dérangeant par le passé.
Son épilogue se révèle bien plus percutant en revanche, entre l’alcoolisme de l’un et le sommeil continue de l’autre. Ce qui nous mène avec un cynisme romantique au suicide du couple. Ses événements tragiques étant renforcés dans leurs mélancolies par la luminosité quasi-constante de l’épisode. Common People s’inscrit donc un épisode dans la moyenne de la saga et comme une reprise encourageante sous la plume de Charlie Brooker. Même s’il manque de fantaisie.
MA NOTE :

Les crédits
RÉALISATION : Ally Pankiw / SCÉNARIO : Charlie Brooker / DURÉE : 57mn
AVEC : Rashida Jones & Chris O’Dowd
Épisode 2 : Bête Noire

L’arrivée d’une ancienne connaissance dans l’entreprise où elle travaille perturbe une jeune femme… D’autant plus qu’elle est la seule à voir quelque chose d’étrange chez elle.
Pour son deuxième épisode, Black Mirror renoue avec son style décalé, entre comédie et climax anxiogène. Un naturel qui colle parfaitement au style British d’origine de la saga, et dont Bête Noire va puiser avec efficacité. De sa distribution jusqu’à sa mise en scène habile – que l’on doit à Toby Haynes. (Andor, Sherlock, Black Mirror saison 4…). Et c’est cette fois dans un environnement approprié : celui du travail, que la série développe son thriller parano.
En 50 minutes, deux têtes d’affiche qui s’oppose à plusieurs niveaux et une succession de rebondissements décalés, Bête Noire dévoile une intrigue commune, mais farouchement efficace. De son découpage journalier annoncé à coup d’orgue à son contexte qui peut se révéler toxique, la série enchaîne les scènes dans un déroulement qui crève les yeux, mais qui convainc dans sa démonstration de genre.

Cette réussite, on la doit à son atmosphère efficiente qui prend le temps d’épaissir cette descente aux enfers, mais aussi à sa distribution féminine idéale. Siena Kelly (inconnue pour ma part jusqu’alors) qui incarne la charmante employée ambitieuse, avec un léger côté cassant, et surtout sa chimère jouer par Rosy McEwen. L’actrice britannique, au visage angélique incarne parfaitement cet ange vengeur aux dons informatique aboutis.
Et justement quand Bête Noire dévoile son twist final, que le ridicule de la situation est rattrapé par son déchaînement de haine qui explose à l’écran. (Et parallèlement la tête de Verity, dans un retournement bienvenu). Un exercice de style léger, mais tout de même très agréable quand elle questionne le pouvoir et la force des blessures passés.
MA NOTE :

Les crédits
RÉALISATION : Toby Haynes / SCÉNARIO : Charlie Brooker / DURÉE : 50mn
AVEC : Siena Kelly & Rosy McEwen
Épisode 3 : Hôtel Rêverie

Le remake high-tech d’un film classique envoie sa star dans une autre dimension, où elle doit s’en tenir au scénario si elle veut espérer rentrer chez elle.
Pour le troisième épisode de sa saison, Black Mirror dévoile son premier segment réellement ambitieux avec Hôtel Rêverie. Dans son mélange de Science-fiction qui s’imbrique dans l’hommage aux films noirs (et la critique des studios qui les exploitent gentiment), Charlie Brooker imagine un univers S.F. entre réalité et fantasme rétro. Sur un fond de romance virtuelle qui rappelle forcément le magnifique San Junipero (saison 3, 2016).
Dans un montage conséquent de 1h17, cet épisode nous questionne sur la création de la conscience individuelle des I.A. Un sujet largement exploité par le passé dans le genre de la S.F. d’anticipation, mais qui dispose d’une revisite intéressante avec Hôtel Rêverie. Notamment, lorsqu’il place l’action de son épisode dans une intrigue d’époque.
En remplaçant la figure classique de l’homme blanc de 40 ans par une actrice afro-américaine issue du stand-up – Issa Rae – cet épisode apporte un tempo inédit au traitement de son sujet. Ainsi qu’à la romance qui demeure en son centre.
Princesse rêverie
Il faut néanmoins quelques dizaines de minutes à cette anthologie pour réellement nous placer au cœur de l’action, durant laquelle la narration use d’un montage alterné entre la fiction et la réalité. Hélas, ce montage excessif (nécessaire à la cohérence de son sujet) dissipe l’immersion dans son monde S.F. Qui révèle pourtant, à terme, une belle sensibilité.
Cette sensibilité, on la doit à la prestation tout en émotions contrites d’Emma Corrin. Artiste déjà bouleversant dans son rôle d’époque de la jeune Princesse Diana. Le récit explore ainsi la prise de conscience effective d’une I.A., coincée à la fois entre celle d’une artiste troublée et des lignes de code qui n’ont pas conscience du monde réel. Cette actrice d’époque se découvre ici à un amour sincère, à l’instar de son actrice plongée dans cette réalité virtuelle.
Pourtant, malgré une distribution très solide (compléter par les prestations de Awkwafina et Harriet Walter), et son sujet riche de possibilités (comme cette exploitation rentable et concise d’un grand classique), Hôtel Rêverie ne parvient pas à délivrer l’immersion totale nécessaire à la réussite de son plein potentiel. Et c’est bien dommage.
MA NOTE :

Les crédits
RÉALISATION : Haolu Wang / SCÉNARIO : Charlie Brooker / DURÉE : 1h17
AVEC : Issa Rae & Emma Corrin, mais aussi : Harriet Walter et Awkwafina
Épisode 4 : Plaything

À Londres, dans un futur proche, un excentrique suspecté de meutre est associé à un jeu vidéo atypique des années 90 qui héberge une société de formes de vie numériques.
Aussi imparfait soit-il, l’épisode interactif Bandersnatch, sorti en décembre 2019, disposait de quelques atouts. Son concept narratif d’abord, mais aussi son esthétisme léché. Réalisé par David Slade, adepte du cinéma de genre, le Britannique savait mettre en images un Londres rétro et d’autant plus aujourd’hui sous son format en 4:3. Un artifice clinquant déjà-vu, mais à qui a fait son œuvre et qui se révèle tout aussi réussi dans cet épisode intitulé Plaything.
Charlie Brooker fait ainsi coïncider ses univers dans une intrigue au montage double. Entre son interrogatoire (confession) en 2034 et son histoire en 1994, Plaything jouit d’un montage et d’une mise en œuvre plutôt efficace. D’autant qu’elle est narrée et interprétée, en partie, par l’excentrique britannique Peter Capaldi. Non sans humour et dans un climax paranoïaque idéal, l’apparition de Will Poulter (dans un caméo expédié) permet ainsi cette filiation nécessaire, qui ouvre la voie vers un récit S.F. de plus en plus inquiétant.
Ici, ce modeste épisode parvient à dévoiler une étrange attraction envers ce jeu vintage et les petits habitants qui le compose. Le jeu d’acteur du jeune Lewis Gribben contribuant d’autant plus à cet aspect d’addictions paranoïaque sous acide, menant sans surprises jusqu’au meurtre. Le tout sous une caméra survoltée. Preuve que dans sa plus simple et énergique exécution, la série de Charlie Brooker fonctionne toujours à merveille dans ses récits excentrique. En terre anglaise. Notamment quand elle allie humour et paranoïa.
Ses dernières minutes nous précipitent naturellement vers sa fin what the Fuck comme son créateur les aiment et qui fonctionnera pour tout à chacun. Assurément, cet épisode manque d’un message de fond, mais il demeure un exercice aussi inutile que plaisant.
MA NOTE :

Les crédits
RÉALISATION : David Slade / SCÉNARIO : Charlie Brooker / DURÉE : 46mn
AVEC : Peter Capaldi, Lewis Gribben, James Nelson-Joyce, Michele Austin, avec Asim Chaudhry, et Will Poulter
Épisode 5 : Eulogy
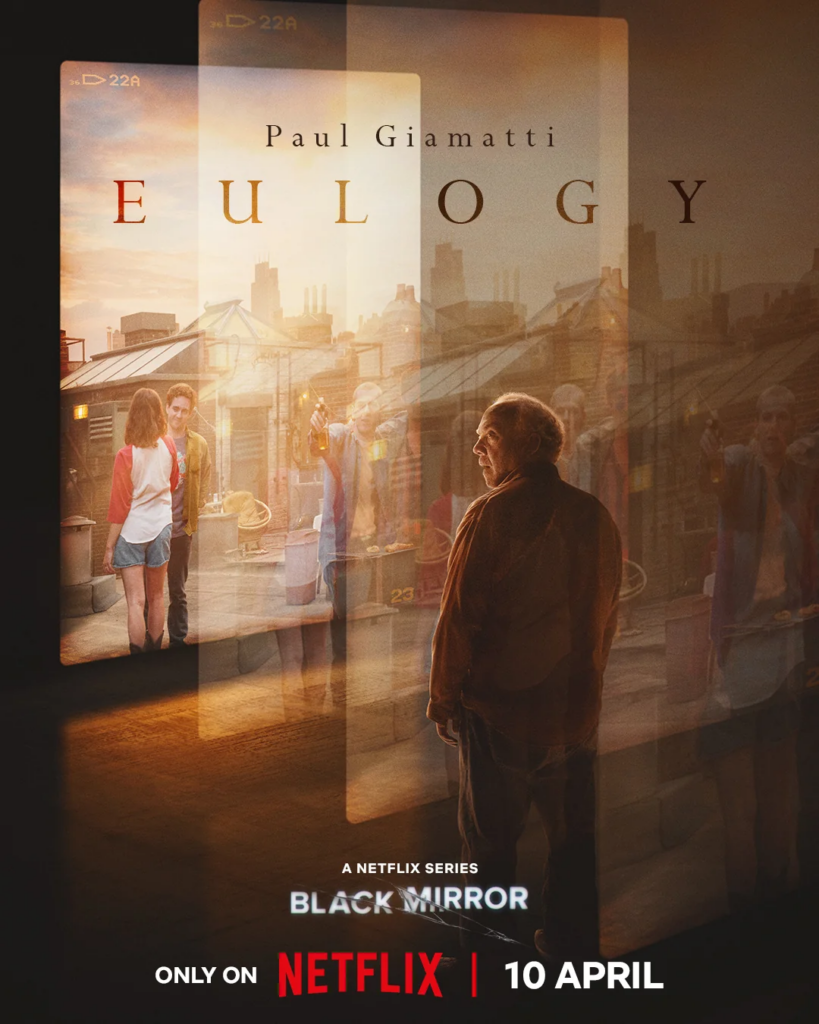
Un homme solitaire est initié à un système révolutionnaire permettant aux utilisateurs de pénétrer à l’intérieur de vieilles photos et de ressentir ainsi de très fortes émotions.
Avec Eulogy, la saga d’anticipation renoue cette fois avec la fable mélancolique. Via un postulat de Science-fiction qui ne blâme pas la technologie, mais en fait un instrument qui place l’humain devant ses fautes et ses rancœurs passés. Sans nous assommer d’explications au préalable, cet épisode et ses scénaristes (Charlie Brooker accompagné d’Ella Road) se servent de leur postulat S.F. comme d’un outil de narration explicatif.
Pour cela, l’intrigue dresse peu à peu le portrait et la personnalité d’un homme seul et aigri incarné par Paul Giamatti. L’Américain incarne avec excellence cette figure amère qui se replonge peu à peu dans ses souvenirs, à la recherche d’un visage disparu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec ce procédé très simple mais efficient, combiné au talent du quinquagénaire, le récit fait mouche.
Eulogie : un procédé pour voir la vie.
Il y a, à la fois beaucoup d’élégance et de mélancolie dans son procédé de Science-fiction qui met en avant le sens des émotions. Notamment, lorsqu’on se plonge à taille réelle dans ses photos. De plus, en ajoutant une voix-off également représenté par le visage de Patsy Ferran, Eulogy apporte une belle nuance et opposition au point de vue présenté. À savoir ici, des rancœurs envers un amour perdu, construit à partir du silence.
Si son cheminement ne révèle pas de grosses surprises à proprement parler (pour qui est attentif), force est de constater que cet épisode maîtrise de bout en bout son exercice de style. Qu’il soit sensoriel comme démonstratif. Pour cela, la mise en scène élégante du duo Christopher Barrett & Luke Taylor est idéal. Tout comme sa bande originale s’avère suffisamment sobre et poignante dans son utilisation.
Et bien sûr, avec 45 minutes au compteur, Eulogy dispose d’un temps d’écran qui s’absout de longueur et frappe la où il faut. Ici, Black Mirror renoue avec sa fable d’anticipation d’antan. Un quasi sans faute dans son genre.
MA NOTE :

Les crédits
RÉALISATION : Christopher Barrett & Luke Taylor / SCÉNARIO : Charlie Brooker et Ella Road / DURÉE : 47mn
AVEC : Paul Giamatti et Patsy Ferran
Épisode 6 : USS Callister – Into Infinity

Bloqués au cœur d’un univers virtuel infini, Nanette Cole et l’équipage de l’USS Callister luttent pour leur survie contre 30 millions de joueurs.
Avec un peu plus de 30 épisodes à son actif, la saga Black Mirror n’avait encore jamais donner suite à l’un de ses épisodes. Et surtout à l’un de ses plus iconiques, tel que : USS Callister (épisode 1, saison 4). Pourtant, 8 ans après sa diffusion, la saga clôture sa 7e saison avec sa suite intitulé « Into Infinity« . Ce retour a déjà la cohérence de ramener réalisateur, scénaristes (au nombre de 4 cette fois) et distribution au cœur de son histoire. Et sous une durée record de 1h30.
L’intrigue se place ainsi quelques mois après le semi happy-end de l’épisode d’origine et évolue sous une double ligne narrative très efficace. Plus efficace encore, Into Infinity use d’un ton comique et satirique absolument croustillant. Ce qui, en plus de son fil rouge, va apporter une fluidité très appréciable à ce mini film d’1h30.
En son centre, ses scénaristes replace le personnage central joué par la géniale Cristin Milioti comme Capitaine du vaisseau. L’actrice, récemment auréolé pour sa performance dans The Penguin, fait preuve de tout son lead féminin à l’écran, mais également sous une autre facette, plus frêle et qui aura son importance dans son contexte narratif.
Infinity 2.0
Et c’est justement en replaçant son récit sous deux facettes presque égales – entre réalité et fiction – que cette suite développe intelligemment la cohérence de son univers. En confrontant justement ses deux univers, leurs avatars et donc leurs désirs d’émancipation. Deux univers, deux facettes satiriques.
Et pour étayer son propos Into Infinity offre à Jimmi Simpson un double rôle absolument génial. Avec d’un côté, le patron orgueilleux et imbu et de l’autre, le résidu de l’univers broyer par la solitude. Ou soi : le méchant bien mégalo de cette nouvelle histoire et parallèlement un atout comique de poids. (avec sa pierre, simili Wilson de Seul au monde, à mourir de rire…).
Le résultat final paraît léger, mais traite pourtant à merveille ses quelques personnages, tandis qu’Into Infinity réussi à être un exercice de divertissement S.F. exaltant. Entre aventure intergalactique et calvaire psychologique. Avec beaucoup moins de cruauté que son premier épisode, mais d’autant plus d’humour. Toutes ses références S.F. n’étant qu’un plus, à l’instar de ses costumes kitsch, à l’immersion de cette suite très réussi d’USS Callister.
Black Mirror parvient ainsi, et encore, à surprendre, notamment après sa superbe scène qui remet en scène Jesse Plemons en inventeur de génie isolé. Petit rappel effrayant lorsqu’on offre les pleins pouvoirs à un esprit dérangé. Un élément scénaristique que la saga d’anticipation maîtrise bien.
MA NOTE :

RÉALISATION : Toby Haynes / SCÉNARIO : Charlie Brooker, Bisha K. Ali, William Bridges, Bekka Bowling / DURÉE : 1h30
AVEC : Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Billy Magnussen, Osy Ikhile, Milanka Brooks, Paul G. Raymond, et Jesse Plemons